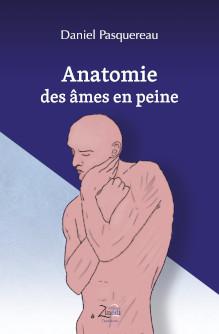 Anatomie des âmes en peine
Anatomie des âmes en peine
Extrait du roman de Daniel Pasquereau
Chapitre premier - Je serai la sentinelle
Soudain, il fut plongé dans l’obscurité et le silence. Il ne voyait ni n’entendait plus rien, pas même son propre souffle ni les battements de son cœur. Il n’éprouvait plus le poids de son corps, incapable d’esquisser le moindre mouvement. Après quelques instants de stupeur, il s’efforça de se calmer et de penser de manière rationnelle comme il l’avait appris pendant sa formation militaire. Mais l’angoisse était forte et il n’y parvint pas tout de suite. Des images mentales incohérentes le traversaient, comme lorsqu’une forte fièvre vous empêche de basculer dans le sommeil réparateur. Il vit d’abord un train blindé lancé à grande vitesse qui rejetait de la vapeur telle une bête féroce écumant de rage. Aussitôt après, le portrait d’une très belle et mystérieuse jeune femme lui apparut dans son cadre doré. Le tableau oscillait devant ses yeux, on aurait dit qu’il flottait dans les eaux vertes d’un lac. Puis ce fut une rue où circulaient à grand-peine des files de taxis pris d’assaut par les passants, vision d’une ville étrangère qui s’enchaîna avec celle, encore plus fugitive et lointaine d’un paysan au chapeau conique ramant sur un canot en forme de cercueil. Un homme qu’il connaissait, peut-être ? Un parent ? Il aurait voulu s’attarder pour lui donner un nom, lui faire un signe, mais les images s’enchaînaient sans l’attendre. La scène suivante se situait dans un grand magasin. Une sorte de garnement en costume cintré et chapeau mou riait en brandissant sous le nez de la caissière un sac de toile rempli de rasoirs usagers. « Je vous aime », susurrait le client patibulaire à l’oreille de la caissière effarouchée, « je veux vous posséder tout entière », ajoutait-il d’un air canaille et cependant, tout ce qu’il semblait avouer pour elle seule était audible pour les clients à travers les haut-parleurs du magasin, et tous avaient le visage de son père… Il vit encore des affiches de propagande politique qui s’entassaient sur le plancher d’un grenier poussiéreux. Mêlés aux affiches, des papiers gras tachés de sauce rouge brun comme du sang coagulé. Par une fenêtre ouverte, on entendait grincer des engrenages industriels (ou était-ce le cliquetis d’une mitrailleuse que l’on arme ?). Quelque part à un étage inférieur de ce capharnaüm mental officiait un dentiste. On ne le voyait pas mais il était bien présent, occupé semblait-il à quelque tâche inavouable pour un praticien honnête. Très haut dans le ciel venteux, un téléphone sonnait par la bouche des corbeaux, il sonnait avec insistance. Personne ne décrochait le combiné…
Mais voici que ce ballet d’images affolées s’estompe. Aurait-il enfin réussi à canaliser sa peur ? À nouveau, il entend sa respiration et, mieux encore, il se souvient de quelque chose. D’une réalité. D’une réalité du quotidien, précisément. Une phrase commence à se former dans son esprit. D’abord, comme si une craie la traçait sur un tableau, il perçoit une trace sonore, et bientôt la trace se change en syllabes, qui se changent en mots. C’est la Voix Fantôme, il la reconnaît, elle parle du plus profond de lui-même et cependant, on la croirait prononcée par un autre, un speaker enfermé dans un antique récepteur radio à galène : « Notre grande et valeureuse armée occupe une province au cœur d’une vaste contrée ennemie où nous faisons régner l’ordre. »
— Notre armée, oui… Je me souviens.
— Qui es-tu ? demande la Voix Fantôme.
— Je ne sais pas.
— Fais un effort. Ne serais-tu pas le sergent Moon ?
— Oui, en effet, je suis le sergent Moon… Et toi, qui es-tu ?
— Je suis la petite voix intérieure du sergent Moon. Tu ne me reconnais pas ?
— Si, je te reconnais. Évidemment que je te reconnais, tu as toujours été là… Mais où suis-je ? Que se passe-t-il ?
— Tu es blessé et tu gis le nez dans la boue… Des gens se battent autour de toi mais j’ai l’impression que tu n’en as pas vraiment conscience.
— Si, si, j’entends les cris maintenant, la fusillade. C’est une bataille, c’est la guerre…
— La guerre, en effet. Te souviens-tu comment tu es arrivé sur ce champ de bataille ?
— C’est difficile à expliquer, il faudrait que je remonte le temps… Au début tout allait bien, la campagne se déroulait selon les plans de l’état-major… Nous avions livré assez peu de combats et les autorités locales avaient admis la défaite, les élites politiques, intellectuelles et religieuses s’étaient montrées coopératives. La population et les infrastructures n’avaient pas subi de dommages significatifs. Le commerce et l’industrie paraissaient n’avoir jamais cessé de fonctionner. La région pacifiée, les gens allaient et venaient dans les rues, occupés à leurs affaires courantes. Tout le monde pensait que cette guerre était déjà finie.
— Mais ?
— Comme toutes les armées d’occupation, nous avons appris à nos dépens que le feu n’est jamais éteint, qu’il continue à couver sous la cendre… Nous avons d’abord subi quelques agressions isolées contre les sentinelles postées devant les administrations ou envers les agents chargés de la circulation. Ici ou là, il arrivait qu’un homme plus téméraire que les autres se jette sur une patrouille avec un gourdin ou un tournevis, aussitôt capturé, le plus souvent abattu sur place. Puis des attroupements hostiles se sont formés jusque devant les commissariats et les casernements. Ceux qui nous provoquaient n’étaient plus des individus isolés ayant fomenté leur coup dans une chambre pendant la nuit. Désormais ils se réunissaient en secret, votaient des actions avec des modes opératoires précis. Tel jour, à telle heure, à tel endroit, ils se regroupaient et criaient en levant le poing des slogans qu’ils avaient répétés. S’il ne s’était agi que des citadins, les manifestations auraient été vite réprimées : on bloque une rue à chaque bout, on arrête les rebelles, on en fusille une douzaine, et les autres vont croupir au cachot… Mais l’affaire s’est compliquée quand les paysans se sont mis de la partie. Des échauffourées ont éclaté un peu partout dans les campagnes, beaucoup plus difficiles à contenir, et la guerre a recommencé…
— Très bien, continue.
— Il y a quelques jours, le colonel a décidé d’envoyer notre bataillon dans la jungle pour mater une révolte près d’un barrage fluvial. Je me souviens que sur la route nous étions nerveux, c’était comme un pressentiment. Nous venions d’effectuer une longue marche en plein soleil sur une piste caillouteuse à flanc de colline, avec des éboulements qui manquaient de nous précipiter dans le ravin. En plus, avec trente kilos de barda sur le dos et ces foutues chaussures inadaptées aux chemins pentus, nos mollets tremblaient comme ceux des grand-mères séniles…
— Venons-en aux faits, Moon.
— J’y arrive. Voilà que, tout à coup, juste avant d’arriver au barrage, ça commence à péter. On nous tire dessus depuis les collines, à travers les arbres. Mais très vite, ça s’arrête. Vite, on relève les blessés et on dégage. Sur place, pas une âme qui vive. Juste le sifflement du vent. Le poste de garde du barrage et la salle des machines avaient été abandonnés, il restait juste des boîtes de conserve vides, quelques outils, des gants et des chiffons graisseux laissés sur les établis… La piste se terminait là. La 1re section est restée sur place et nous, c’est-à-dire la 2e section, nous avons pris le sentier qui s’enfonce dans la forêt. Il menait à un village niché dans une clairière. Là aussi, personne. Une quarantaine de huttes formaient un cercle autour d’une placette poussiéreuse et bosselée. Après que le capitaine eut réquisitionné le bazar pour y établir son quartier général, et alors que nous formions notre campement…
— C’est quoi déjà, le bazar ?
— Nous l’avons tout de suite surnommé le bazar par ironie, mais c’était plutôt le genre d’entrepôt où l’on trouve ce qui est nécessaire à la vie courante : sel, huile, riz, viande et poisson séché mais aussi du fil de fer, des briques et des manches de pioche. Quelqu’un devait aussi y faire l’école, car il y avait un bureau avec du papier et des crayons… Donc, alors que nous formions le campement, nous avons entendu un coup de feu et encore un autre. En quelques secondes, ça s’est remis à canarder dans notre direction. Visiblement, on nous suivait. Mais le temps d’organiser la riposte, nos assaillants s’étaient à nouveau évanouis au plus profond de la forêt. J’ignore si nous avons réussi à en toucher un, mais, de notre côté, deux types gisaient, raides morts, et un autre retenait ses tripes entre ses doigts… Heureusement, il ne s’est rien passé de fâcheux pendant la nuit. Dès le lendemain matin, nous avons réussi à rattraper les habitants du village qui s’étaient réfugiés dans une grotte, une centaine, qu’on a ramenés à coups de baïonnette dans le cul et qu’on a parqués sur la place. Le capitaine est sorti du bazar, il était blanc de rage.
— Qu’a-t-il dit ?
— Il les a menacés, évidemment, il voulait qu’ils parlent.
— Pour dire quoi ?
— J’y viens, inutile de me couper sans arrêt la parole ! Il a exigé des renseignements sur la résistance mais pour être honnête, l’heure n’était pas aux palabres. Les villageois baissaient la tête d’un air obstiné et les nôtres étaient tellement remontés qu’ils voulaient passer tout le monde par les armes sans plus de procès, y compris les femmes, les enfants, les vieillards et même les cochons et les chiens s’il y en avait eu. Mais les bêtes sont plus rusées que les hommes, elles disparaissent dès qu’il y a du grabuge. Après avoir apaisé les esprits échauffés, le capitaine a dit qu’il voulait s’entretenir avec le chef du village, d’homme à homme, et que tout se passerait bien s’il se montrait coopératif. Sauf que les choses ont mal tourné…
— C’est un euphémisme !
— Oui, mais moi, je n’y suis pour rien. Je ne suis qu’un soldat et, comme tous les soldats, j’obéis aux ordres. Et puis je n’y étais pas, je n’ai pas vu la suite. Quand le capitaine a commencé l’interrogatoire du chef du village, j’étais déjà reparti en patrouille avec une escouade.
— À t’entendre, vous ne faites que cela, vous, les soldats, obéir aux ordres encore et toujours. C’est un peu facile, non ?
— Ah, merde ! Tu m’agaces à la fin, fous-moi la paix !
Le chef du village pouvait avoir aussi bien quarante que soixante ans ou plus. Malgré son dos voûté par des années de fardeau, ses côtes saillantes zébrant son torse nu, sa barbiche crasseuse et sa houppette de cheveux blancs, il émanait de sa personne une forme d’autorité.
Il écouta le capitaine sans broncher en mâchouillant un vieux mégot éteint. Rien n’avait prise sur lui. Au bout d’une heure, le capitaine perdit patience. « Je vais te faire décapiter devant tout le village », dit-il, mais sans élever la voix. Quand il était en colère, il parlait entre ses dents et alors tout le monde comprenait que la foudre allait bientôt s’abattre. Mais au moment de désigner un bourreau, le capitaine changea d’avis : il n’y aurait pas un, mais deux suppliciés. Et même deux par jour tant que les informations sur les partisans n’auraient pas été livrées. Ensuite, les deux condamnés ne seraient pas décapités mais enterrés vivants, et ainsi de suite, même châtiment pour les autres.
Un orage tropical éclata pendant que les soldats creusaient les tombes. Le ciel s’assombrit subitement, le vent se leva et dès la première bourrasque les nuages crevèrent, libérant des trombes d’eau. C’était une pluie tiède qui martelait les toits des huttes à grosses gouttes, transperçant la terre comme des volées de flèches, pénétrant les vêtements et la peau jusqu’à l’os.
La deuxième victime fut tirée au sort. Le hasard tomba sur une adolescente, une fille d’une beauté particulière, du genre sauvage. Il y eut des cris, des pleurs. La tigresse s’agrippait si fort à sa mère qu’il fallut lui faire lâcher prise en lui écrasant les doigts à coups de crosse et ensuite agir de même avec la mère, une véritable furie elle aussi, toutes griffes dehors, mordant, giflant, battant des mains et des pieds. On l’assomma. Puis les soldats furent obligés de traîner l’adolescente par les cheveux pour la jeter dans le trou.
De son côté, le petit homme ne manifesta aucune résistance, il s’allongea dans la terre glaiseuse et ferma les yeux. Les pelletées commencèrent à recouvrir leurs corps, les pelles étaient dures à manier à cause de la boue collante, il fallut quatre hommes pour arriver au bout. Une fois la tâche accomplie et après un demi-tour réglementaire lourdement exécuté dans la gadoue, le peloton se positionna en cordon autour des deux tombes pour empêcher la population de s’en approcher.
Des torrents d’eau jaunâtre se déversaient des toits sur le sol inégal, et l’averse continuait à crépiter, recouvrant de son bruit de mitraille les plaintes et les suppliques des familles. Finalement, en désespoir de cause, les villageois se réfugièrent sous les auvents des huttes, les yeux rivés vers le centre de la place gardée par les uniformes dégoulinants de l’envahisseur.
Voilà qui est fait, se dit le capitaine. Les fesses posées sur le bureau du bazar, il allume un cigare. Il a quitté ses bottes et sa capote trempée. Son aide de camp vient de lui servir un thé brûlant qu’il lape à petites gorgées bruyantes.
Ce quinquagénaire ventripotent à la moustache en broussaille, au teint cireux, est un homme plus complexe qu’il n’y paraît. Vu de l’extérieur, il ressemble à un brave commerçant ou à un employé de banque hépatique. Abstraction faite de son uniforme, on le croirait doux comme l’agneau. Et quand on fait l’effort d’accrocher son regard éteint, on le prendrait presque en pitié. Car il est veuf depuis peu et chacun sait, au sein du bataillon, qu’il demeure inconsolable de la perte de son épouse adorée. Comment la cruauté pourrait-elle entrer dans le caractère d’un tel homme qui pleure en silence chaque soir dans son lit à la pensée de sa défunte femme ? Par ailleurs, il est réputé pour être un chef attentif au moral de la troupe et toujours juste dans ses décisions. Il ne punit qu’à bon escient, non sans avoir pesé le pour et le contre, écouté les arguments de chacun avant de rendre son verdict. Les châtiments sont toujours proportionnels à la faute. Dans l’esprit de ses hommes, il n’est donc pas question de cruauté ou de sadisme dans la décision qu’il a prise. En ordonnant l’exécution d’un quidam qui aurait pu être son père et d’une jeune vierge en âge d’être sa fille, il n’a fait qu’appliquer un principe de base appris il y a longtemps sur les bancs de l’école militaire : dans les moments critiques, la réaction appropriée est de frapper sans attendre et de la manière la plus forte. Il faut marquer les consciences. C’est ainsi que l’on parvient à éviter la surenchère et de nouvelles victimes inutiles.
— Et tu y crois…
— Bien sûr que j’y crois. Qu’est-ce qu’un parfait soldat ? C’est un dard de scorpion avec une cervelle de singe et un cœur d’éléphant.
— Qui a dit cela ?
— Le capitaine.
— Des mots, du vent… L’expression pathétique du folklore guerrier… Un cœur d’éléphant, ça ne veut absolument rien dire.
Le capitaine lui-même ne croit pas toujours aux slogans percutants qu’il assène à ses troupes. Dans la cahute, il suit d’un œil les traînées de pluie sur le carreau. Et en soufflant la fumée âcre de son cigare, il songe à ces deux villageois. Il ne peut s’empêcher de les imaginer dans leur trou, se débattant en vain pour échapper à l’asphyxie, le torse opprimé par le poids de la terre, soufflant, crachant ce qu’ils peuvent par leurs narines et leurs bouches déjà obstruées.
En toute logique, leur trépas n’est qu’une affaire de quelques minutes. Cependant, se dit le capitaine, il pleut si fort qu’il suffirait de rien, d’un effondrement du terrain détrempé pour que ces deux-là ne parviennent, juste avant de rendre l’âme, à s’extirper de la terre en invoquant les âmes de leurs ancêtres et en réclamant la vengeance de leurs dieux. La situation pourrait alors basculer. En assistant au miracle des deux condamnés renaissant de la boue comme des démons, ces bougres de paysans arriérés seraient capables de sortir en masse de leurs masures, bousculant le cordon de gardes, cherchant le corps-à-corps malgré l’évidence de leur infériorité.
Le capitaine est de cette génération d’officiers élevée entre deux époques. D’un côté, il a passé sa jeunesse à étudier la stratégie, il réagit avec un esprit mathématique, il croit au progrès de l’armement et aux nouvelles techniques de combat, il ne méprise pas la diplomatie moderne. D’un autre côté, il a conservé les superstitions transmises par ses aïeux. Dans l’intimité, il croit aux puissances des ténèbres, et la situation présente lui fait peur par instinct.
À ce stade, raisonner militairement ne lui est pas d’un grand secours. S’il fait appel à ses connaissances, il se souvient, pour l’avoir étudié puis enseigné lui-même, que des armées entières se sont ridiculisées dans le passé, bien que puissantes en théorie. Il cite souvent une célèbre bataille menée par un général valeureux à la tête d’une cavalerie de nobles chevaliers, appuyée par des régiments compacts de fantassins, tous en place pour le choc et riant de la faiblesse du camp d’en face. L’assaut est proche mais tout à coup, ils reçoivent sur la tête une volée de flèches lancées par une poignée d’archers habiles. Rien de trop alarmant mais les chevaux n’ont pas d’armure, ils sont touchés et tombent les uns sur les autres, entraînant dans leur chute les cavaliers lourdement harnachés. En une minute à peine, toute la noblesse du royaume se débat pour s’extraire des flancs ensanglantés des destriers. Et voilà que l’infanterie dans sa lancée vient s’écraser sur ce mur et ne parvient pas à franchir l’obstacle. Pendant ce temps, les ennemis, bien que moins nombreux et mal équipés, en profitent pour se ruer sur la masse empêtrée des cavaliers et des fantassins qu’ils achèvent à la hache. Une bataille impossible à perdre vient pourtant de l’être par pure vanité. Mais le pire, c’est ce qu’il en restera dans les esprits. Les noms de ces officiers vaincus sont à présent honnis, la honte rejaillit sur leurs descendances. Le capitaine ne veut pas être de ceux-là, il ne veut pas figurer parmi ces fantômes pleurnichards errant éternellement sur les champs de bataille… Dans ces moments-là, il n’y a pas plus de « dard de scorpion », que de « cervelle de singe » ou de « cœur d’éléphant ».
Aussi, écrasant son cigare sur la table, il sort du bureau au pas de charge. Que l’on renforce le cordon de gardes ! Que l’on place une mitrailleuse à chaque coin de la place ! Que l’on allume des projecteurs ! Puis il lui vient une autre idée. Que soit désignée parmi les hommes une sentinelle particulière ! Il lui faut un homme jeune, grand et fort, vêtu en habit d’apparat avec le casque à plume, la cape, la fourragère, les gants blancs, etc. Une sentinelle exceptionnelle, symbolique, qui gardera les deux tombes comme s’il s’agissait d’un lieu tabou. Car la crainte inspirée par la puissance militaire à la populace est une chose, mais il faut également savoir faire impression face aux forces surnaturelles. Si les paysans sont bel et bien protégés par des dieux, ces pauvres divinités domestiques comprendront que, derrière le géant casqué brandissant son oriflamme, d’autres dieux, plus forts, voués à la guerre, sauront leur faire rendre gorge. « Et puis, non, rugit le capitaine, on ne désigne personne. Je veux un volontaire ! » Sur ce, il rentre dans le bazar en claquant la porte.
C’est à cet instant que Moon revient de patrouille à la tête d’une escouade de dix hommes, tous trempés, fourbus et encore sous le coup du stress lié à leur incursion au cœur des ténèbres. Ils n’ont qu’une idée : se mettre au sec avec un thé brûlant.
Avant de les rejoindre, Moon doit faire son rapport. En attendant d’être reçu par le capitaine, il se fait expliquer de quoi il retourne. Pourquoi toute cette agitation, la garde renforcée, les mitrailleuses, le regard haineux des villageois ? « Tiens, tiens », se dit-il en écoutant le récit du planton avec un intérêt croissant.
— Mon capitaine, je serai la sentinelle.
— Et pourquoi vous, sergent Moon ? Vous n’êtes ni grand, ni beau, ni fort.
— Certes, mais j’ai un atout. Je ne me contente pas de croire aux fantômes comme un poltron superstitieux, je les vois.
— Que me chantez-vous là ?
— Avec tout le respect que je vous dois, mon capitaine, je sais très bien où vous voulez en venir avec votre sentinelle. C’est une bonne idée mais la superstition est une arme à double tranchant. À coup sûr, vous réussirez à impressionner et contenir ces abrutis de paysans. Mais qui parmi nous acceptera de se dévouer pour provoquer les dieux ? Nos soldats eux aussi sont des paysans, ils croient plus ou moins aux mêmes divinités et elles les effraient. Avec moi, c’est différent, vous n’avez pas affaire à l’un de ces conscrits analphabètes arrachés de force à leur famille pour aller guerroyer au diable Vauvert (excusez ma franchise). J’ai grandi en ville, je suis issu d’un milieu cultivé, j’ai fait des études et j’ai voyagé. De plus, croyez-moi, malgré ma jeunesse, j’ai déjà subi beaucoup de vicissitudes au cours de mes pérégrinations.
— Vous ne croyez pas à l’existence des dieux et des démons ? Vous êtes sans religion ?
— Bien sûr que non. Je suis croyant, comme tout le monde, mais comme je dialogue avec les fantômes depuis mon enfance, mon approche du divin est spirituelle et non superstitieuse. Déjà, mon propre père côtoyait les morts…
— Taisez-vous, sergent Moon, vous allez trop loin ! Je ne veux rien savoir de vos prétendus pouvoirs et de vos échanges avec l’au-delà, vous me glacez le sang. Êtes-vous volontaire pour cette mission ?
— Je le suis, mon capitaine. Je me sens apte à assurer sans broncher cette garde éprouvante, et si par hasard l’un des deux suppliciés venait à sortir de terre, je lui rirais au nez et je le renverrais dans son trou d’un grand coup de botte dans la poitrine. Je saurai mieux que n’importe qui tenir la position du garde-à-vous, la tête haute et le fusil à l’épaule sans bouger d’un iota car la consigne sur ce plan est des plus strictes. Malgré le vent et la pluie qui dégoulineront le long de mon casque jusque dans mon cou, je mettrai un point d’honneur à conserver un maintien parfait.
— Je vous trouve bien prétentieux, Moon.
— Je suis volontaire, mon capitaine, je n’ai peur de rien.
— Soit. Prenez votre garde, mais sachez que cela peut durer la nuit entière. Le peloton sera relevé toutes les deux heures, mais pas vous. Soyez à la hauteur de l’enjeu, impassible, imposant, surhumain si possible. C’est compris, Moon ?
— À vos ordres, mon capitaine.
— Soyez fier, hein ! Prenez un air supérieur…
— Oui, mon capitaine.
— Vous devez vraiment avoir l’air d’un guerrier implacable. Montrez que vous êtes issu d’une race supérieure.
— Oui.
— Oui qui ?
— Oui, mon capitaine.
— Plus fort !
— OUI, MON CAPITAINE… Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien.
— Je ne m’inquiète pas, bougre d’abruti ! Allez prendre votre garde et fermez votre grande gueule une bonne fois pour toutes.
Dès qu’il se trouve en position à quelques pas des tombes, Moon prend bien soin de lever le menton et de river son regard vers l’infini. Malgré la bruine qui imprègne déjà son front et ses joues, il évite de cligner des yeux. Je suis volontaire, se répète-t-il pour se donner du courage.
Volontaire, il l’est assurément, comme il l’était pour participer à cette guerre, mille fois plus volontaire que les milliers d’autres volontaires de tous les régiments. Ainsi, il avait traversé la moitié du globe terrestre pour s’engager alors qu’il jouissait d’une existence privilégiée dans un continent en paix à l’autre bout du monde, où personne ne serait venu le réquisitionner.
Dans son pays d’accueil, il avait trouvé un travail élémentaire et bien payé, un patron qui le traitait comme un fils, une fiancée délicieuse. Mais alors que tout semblait lui sourire, il avait commis une erreur impardonnable, détruisant son projet de vie en quelques heures. Et comme une guerre venait d’éclater dans son pays, il n’avait pas hésité un seul instant. Il était reparti pour expier sa faute.
Retour à la fiche du livre Anatomie des âmes en peine
Acheter Anatomie des âmes en peine
Ajouter un commentaire