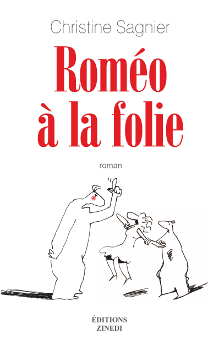– Comment avez-vous eu l'idée de ce roman ?
C’est au plus fort du chaos, alors que ma famille menaçait d’imploser que j’ai ressenti la nécessité d’écrire, pour lever un tabou autour des troubles psychiiques, pour prendre de la distance, pour conserver un certain bon sens et retrouver la notion de plaisir à travers l’écriture. Alors il fallait que ce roman soit drôle…
- Pourquoi choisir l’humour pour traiter d’un sujet si grave ?
C’était vital. Rire pour ne pas mourir. L’autodérision en guise de soupape. Durant cette période, j’ai beaucoup échangé par mails avec une amie qui vivait des évènements similaires. Nous avions choisi de rire de ces situations qui, il faut le dire, frôlaient le burlesque. L’humour était notre garde-fou. Alors quand j’ai commencé à écrire mon roman, j’ai opté très naturellement pour ce ton. J’avais besoin de cette forme d’allégresse pour prendre le contre-pied du désespoir. D’ailleurs, ce sont toutes les failles de mon héroïne qui la rendent drôle et attachante…
– Vous êtes-vous inspirée de faits réels ?
Evidemment je me suis inspirée de mon vécu alors que j’étais confrontée à la crise d’un de mes fils, alors adolescent, mais aussi de témoignages d’autres familles en me basant sur de nombreuses rencontres et lectures, dont la très intéressante étude d’Annick Ernoult et de Catherine Legrand-Sébille Parents de grands adolescents et jeunes adultes hospitalisés en psychiatrie. En fait, le cas de ma famille est loin d’être isolé, et les témoignages se recoupent d’une manière saisissante, jusqu’aux propos des psys qui sont identiques, comme s’ils usaient de formules toutes faites. : « Il y a de la culpabilité qui circule », « C’est un vrai roman-feuilleton votre histoire »… Il est vrai qu’aujourd’hui la psychiatrie fait dans le prêt-à-porter quand elle devrait opter pour le sur-mesure.
– Quel est le thème central de ce livre ?
La lente dérive d’une mère qui veut faire soigner son fils. Saine d’esprit au départ, elle est tellement humiliée, maltraitée, accusée par les psys qu’elle va finir par perdre la tête et tenter de régler son compte à l’un deux. Une juste vengeance. Ce qui, soit dit en passant, est une pure invention. C’est d’ailleurs étonnant, vu le comportement de certains spécialistes, qu’il n’y ait pas de tels faits divers.
- Quelques perles ?
Un psy d’un établissement… à la mode, si j’ose dire, qui nous explique que l’on ne peut pas changer la manière de penser des gens. Cet homme était supposé soigner des anorexiques, des adolescents suicidaires… Ou encore, une psychologue qui nous propose comme solution à la crise que nous traversons après un mois d’hospitalisation (nous devions récupérer notre fils qui ressemblait à une grenade dégoupillée), elle nous propose donc pour les mois à venir qu’il aille en internat durant la semaine, puis qu’il passe un week-end chez son frère aîné, un étudiant de 20 ans vivant en colocation, le second week-end chez une tante célibataire, le troisième week-end à l’hôtel, ceux-là que la DASS met à disposition des personnes en difficulté… Nous n’avons pas voulu entendre ce que nous réservait le quatrième week-end. Un adolescent bien portant n’aurait pas survécu à un tel régime, alors un garçon dont la plus grande peur est l’abandon… Et puis cet autre psy, Professeur tout de même, qui nous dit : « Si vous voulez abandonner votre fils, il faut que vous le lui disiez avec votre cœur » !
– À quels lecteurs s'adresse votre ouvrage ?
À tous les parents ! Ceux qui ont des adolescents un peu agités s’y retrouveront, tout en se sentant rassurés sur leur sort. Ceux dont les enfants vont très mal se sentiront moins seuls avec leurs pensées pas toujours politiquement correctes. Parce que le plus dur peut-être dans ces parcours chaotiques, c’est l’isolement. La tendance actuelle est de vouloir présenter une image idéale de la famille, la réussite des enfants, l’entente cordiale entre parents et enfants… Alors quand tout fout le camp et que l’on ne maîtrise plus rien, on se met à l’écart. Dites que votre enfant fait une thérapie, votre interlocuteur pensera que votre fiston est un peu bizarre ; expliquez qu’il est interné, et il le prendra pour un fou. Et vous avec.
– En quoi votre livre parle-t-il à un lecteur d’aujourd’hui ?
Aujourd’hui, les psychiatres ont souvent la parole. Ce sont des experts que l’on invite pour commenter l’actualité à chaud. Certains sont spécialisés dans le couple comme dans la déradicalisation. Il y a les psys des plateaux de télé, il y a les champions de la théorie, et il y a le psy au coin de la rue que l’on va voir avec son ado sur la prescription d’un prof. Le psy est partout, et paradoxalement le trouble psychique est tabou. Alors je crois que beaucoup se retrouveront dans cette histoire, beaucoup de mères en particulier qui demeurent les cibles privilégiées des psys.
Extrait
Là, sur le quai quasiment désert, sous un ciel d’un bleu cru qui me heurtait la rétine, je ne pus supporter la vue de ce panneau publicitaire qui vantait les vacances en hiver au soleil. Sans que je parvinsse à le contrôler, mon ventre se mit subitement à gonfler tel un ballon de baudruche, puis l’air remonta en tourbillon le long de ma gorge, ma bouche s’ouvrit toute grande. C’était comme si mon corps ne m’appartenait plus. Comme s’il était aux prises avec un typhon intérieur. Mon cœur menaçait d’exploser. Alors, je lançai le plus beau cri primal qui fût, et toute la petite ville entendit cette sirène d’un genre nouveau. Les quelques voyageurs en partance m’examinèrent par en dessous comme on le fait pour observer un fou, mine de rien, en croisant le regard des autres témoins de sa dinguerie, puis ils convergèrent doucement vers l’autre bout du quai, me laissant seule, les membres en coton, le cœur dévasté par ces années de souffrance et d’humiliation.
Quand le train arriva à quai, je sommeillais sur un banc. Après m’être hissée à bord, je m’écroulai sur un strapontin libre. À croire qu’un tombereau de fatigue s’était abattu sur mes épaules. J’avais tout d’un marathonien à la peine : pas de second souffle pour moi, pas d’euphorie, chaque étape de ma vie de mère s’avérait plus ardue que la précédente.
Je piquai du nez et replongeai dans mes cogitations moroses quand un jeune homme se mit à jouer de la guitare, accompagné au chant par une jeune fille noire à la voix de sirène. La douce mélopée me fit l’effet d’un tire-larmes. Je gardai la tête basse pour conserver ma dignité, bercée que j’étais par mes propres sanglots. Jusqu’au moment où un malotru se mit à crier « Ta gueule ! » à la figure de la jolie chanteuse qui chaloupait tout le long du wagon. Je me retournai, le corps raidi comme sous l’effet d’un coup de fouet. La vue brouillée, je distinguai depuis ma place un individu à lunettes, les traits sévères et la lèvre mince, une tête à la Fransec quoi ! Qu’ai-je bien pu penser à ce moment précis ? Je ne sais pas. Que c’était son sosie, son cousin ou pire, son frère jumeau. Oui, le frère jumeau de cette maudite psy en personne, présent, là, dans ce train, pour assister à la déchéance d’une mère en perdition. Pour finir, j’en conclus qu’en plus d’être grossier et raciste, l’homme n’était pas mélomane… À bout, je me levai et, tel un automate, je marchai jusqu’à lui : « Ta-gueu-le-toi-mê-me ! » déclarai-je en détachant soigneusement chaque syllabe. Et dans un geste que personne ne vit venir, pas même moi d’ailleurs, je le giflai.
Dieu, que le lâcher-prise fait du bien ! Être ici et maintenant, avec celui qui est ici et maintenant et devant soi ; mettre toute son énergie dans l’action plutôt que de la gaspiller à se maîtriser. Car adopter l’attitude positive d’ouverture aux autres, c’est aussi accepter l’abruti dans sa différence existentielle et passer à l’acte sans s’encombrer de pensées parasites du genre « Ça me démange de le claquer, mais je suis un être poli et sensé, et lui, quoique fort mal élevé, n’en mesure pas moins deux têtes de plus que moi ! » À bas la mentalité d’assuré tout risque, la beauté du geste est fonction du péril encouru. Quoique… le gros balèze m’aurait flanqué une beigne, les voyageurs en auraient été scandalisés, alors que la situation inverse les invitait à sourire, si ce n’est à applaudir. Il n’empêche, le souffle coupé, l’homme se leva et posa ses grosses pattes autour de mon cou. Sans l’intervention d’un autre costaud, j’y serais restée. Mais bon sang que ce fut bon… comme si le poids du monde avait glissé de mes épaules.
Le lendemain, Lucas et moi reprîmes le chemin de cette lointaine banlieue. Mon pauvre compagnon, je le réalisai soudain, n’était plus que l’ombre de lui-même, la peau flasque et grise, les traits flous, comme si la chair de son visage glissait inexorablement sous l’effet de la pesanteur terrestre. Il n’avait plus de jus, un point c’est tout, et j’avais oublié de lui demander comment s’était passé son précieux rendez-vous. En l’observant plus attentivement tandis qu’il sommeillait sur l’écran noir de son ordinateur, je pensais au masque de Scream que j’avais un jour offert à Roméo. Après l’avoir enfilé, mon Petit Coeur était allé s’admirer dans la glace. Là, contre toute attente, il avait hurlé avant de détaler pour se cacher derrière le canapé, loin du monstre. Il va sans dire que j’évitai de partager ce souvenir avec Lucas de peur que, pris à son tour de panique en se regardant dans le rétroviseur, il ne tentât de se réfugier sous son siège.
Pour en revenir à sa triste mine, elle me broyait le cœur qui était déjà pourtant bien malmené. Ce fut donc dressée sur mes ergots que j’arrivai à destination : il n’était plus question que nous écoutions les salmigondis d’un de ces infatués de psys ! C’est du moins dans cet état d’esprit que j’abordai la première infirmière qui se présenta sur notre chemin, mon humeur virant à l’exécrable au long de l’attente qui suivit. Quand le psychiatre, fâcheusement dénommé Bienaimé, vint enfin nous chercher, la fumée jaillissait de mes oreilles, c’est certain, mais mes ardeurs guerrières faillirent prendre l’eau lorsqu’il nous offrit de nous asseoir sur une banquette en mousse qui nous engloutit. Les genoux à hauteur du menton, le dos en virgule, nous fûmes contraints de relever le menton pour pouvoir regarder notre hôte assis bien droit sur son fauteuil à roulettes. Nul doute que ce dispositif d’accueil visait à faire perdre toute intention belliqueuse aux parents rétifs. S’ajoutait à cela une ambiance réfrigérante due à une baie vitrée grande ouverte qui expliquait peut-être pourquoi le psy ne quittait pas sa veste en peau lainée. À moins qu’il n’ait voulu fuguer, lui aussi, allez savoir ! Il est vrai qu’il semblait s’être trompé d’orientation : petit, trapu, il ressemblait davantage à un boxeur qu’à un spécialiste du cerveau, plus habile eût-on dit avec ses poings qu’il avait velus qu’avec les mots. Mais tout le monde, sauf les psys peut-être, sait que les apparences sont trompeuses.
Quand Lucas lui demanda de quoi souffrait Roméo, car personne jusqu’à présent n’avait jugé bon de nous en informer, il répondit d’une pirouette : « On ne met pas de mots sur les maux. » À quoi je faillis répliquer « Dommage, car les mots pansent les maux », mais il était vain que je m’abaisse à ce petit jeu, d’autant qu’assis à nos côtés, notre Roméo comateux n’avait besoin d’aucun mot pour nous maudire pour tous ses maux. Muets donc, nous sommes restés à écouter notre nouveau pontife. Nullement perturbé par ce mutisme généralisé, le bonhomme poursuivit son laïus à propos d’une soi-disant période d’observation durant laquelle il était crucial de guetter tous les faits et gestes du patient, jusqu’à ses silences qui en disaient long. Et blablabla et blablabla, lui au moins n’avait pas perdu sa langue. Enfin, il nous demanda de lui raconter notre situation en remontant depuis le tout début, loin avant même l’adoption. Là, je le vis loucher sur le dossier médical qu’il tenait fermé sur ses genoux. Illico, j’imaginai les rapports écrits de la main de Fransec, d’une écriture serrée, dans ce langage abscons que les spécialistes sont fiers de partager, trop heureux de n’être compris de personne. Je l’imaginai, sèche et souveraine, souffler son diagnostic à l’oreille de ce confrère de seconde zone, et lui qui ne voulait pas en entendre parler et tenait à poser le sien de diagnostic, qui se devait d’être différent, son honneur en dépendait. Toujours est-il que voir planer l’ombre de cette sorcière sur ce bureau du fin fond de la banlieue me retourna les sangs. Je répondis donc que nous concernant, nous avions dépassé, et de loin, le stade de l’observation ; ce disant, je comptais sur mes doigts, un, deux, trois, et jusqu’à neuf, le nombre de fois que nous avions dû récapituler notre triste histoire.
« C’est un vrai roman-feuilleton, gloussa l’expert en relations interpersonnelles.
– Pour en arriver où ? Ah oui ! m’écriai-je d’une voix suraiguë. Pour en arriver où, je vous le demande ? »
L’air de la pièce éclata en mille morceaux comme une vitre sous le poids d’un pavé. Tout s’effritait autour de moi, et ma raison avec. Le front plissé de grosses rides, Bienaimé se figea avant de nous examiner chacun à notre tour, Lucas ratatiné sur son séant, moi tendue comme un arc, et enfin Roméo qui semblait sur le point de chavirer de son pouf au moindre courant d’air.
L’homme eut alors cette brillante saillie :
« C’est la maman, n’est-ce pas, c’est la maman qui ne veut pas lâcher son garçon… »
Et puis, les yeux comme deux fentes :
« … Je sens qu’il y a beaucoup de culpabilité qui circule… »
 Merci pour ces explications je viens de vous entendre à la tv et cela est un dur combat pour vous . Merci
Merci pour ces explications je viens de vous entendre à la tv et cela est un dur combat pour vous . Merci